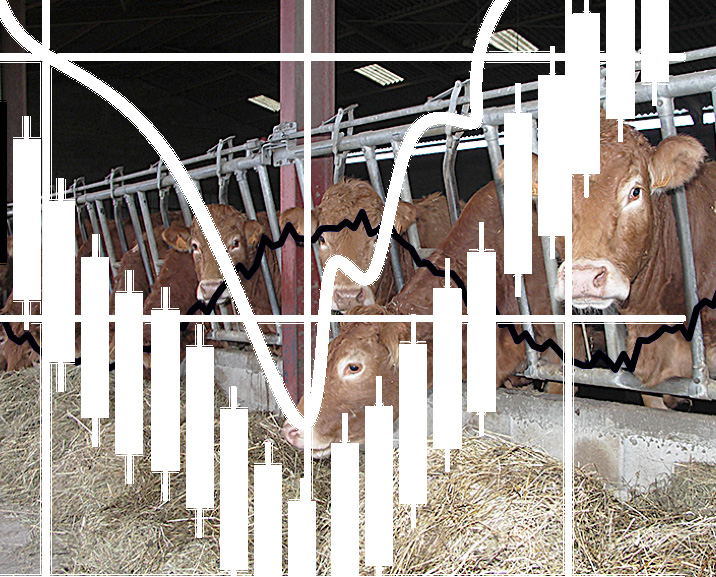- août 26, 2025
- Aucun Commentaire
- 188
Jean-Paul Bordes : « L’agriculture pourra-t-elle s’adapter au changement climatique ? »
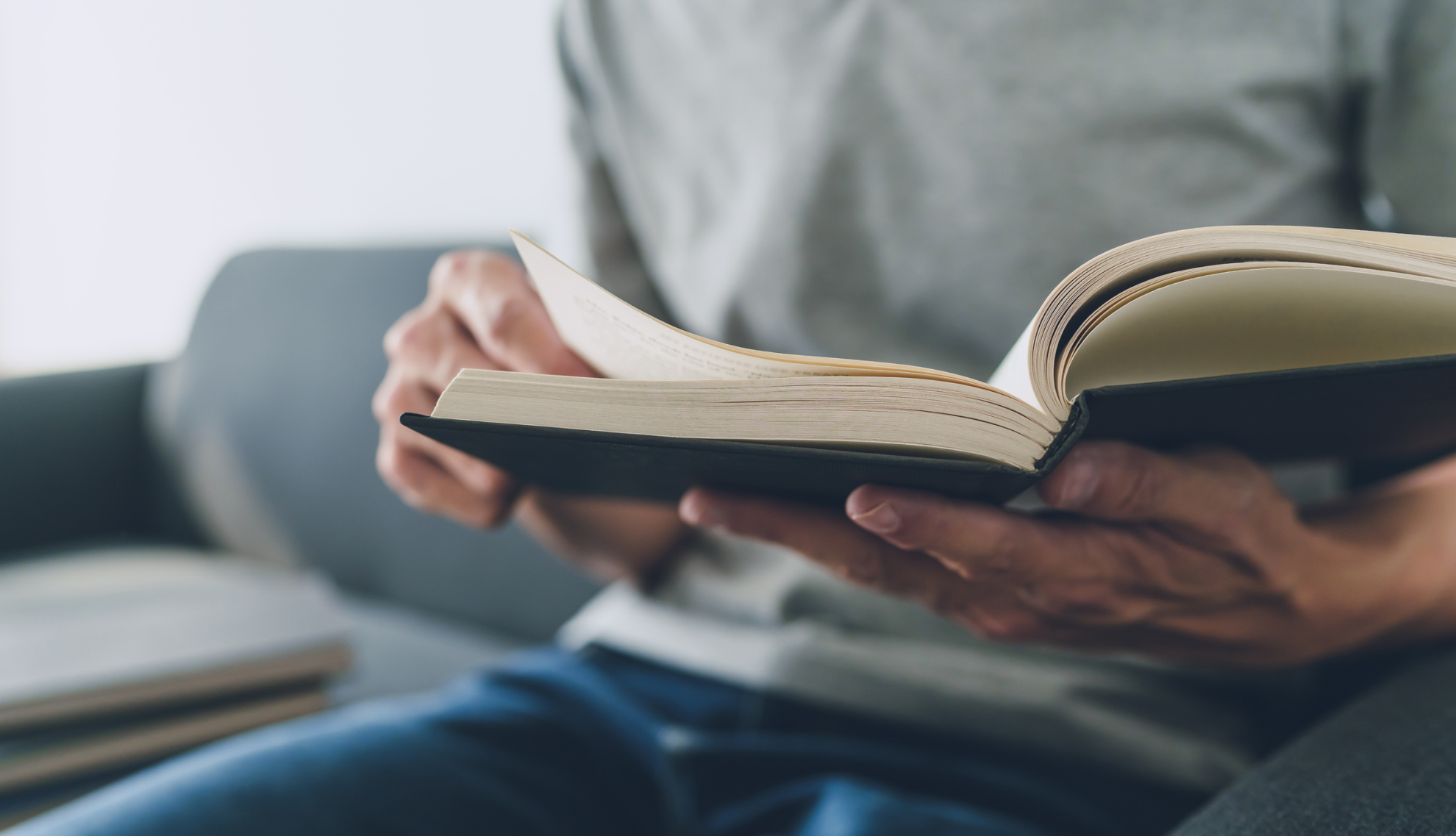
Jean-Paul Bordes, agronome praticien de la recherche agricole appliquée, vient de publier un livre intitulé « L’agriculture pourra-t-elle s’adapter au changement climatique ? ». Malgré la multiplicité des défis (besoins croissants en eau, raréfaction des engrais, renforcement des bioagresseurs), l’auteur croit à la capacité des agriculteurs français à saisir les leviers d’actions et à innover.
Dans un ouvrage de 220 pages qu’il vient de publier, Jean-Paul Bordes, qui vient de terminer sa carrière en tant que directeur général de l’Acta (le réseau des instituts techniques agricoles), est confiant dans les moyens d’actions et les innovations que les agriculteurs peuvent mobiliser pour s’adapter au changement climatique. Il tranche au début du livre le débat « s’adapter ou réduire (l’effet de serre) ? », et fait part de son scepticisme sur l’efficacité du message qu’adressent les pays occidentaux à leurs concitoyens sur la nécessité de réduire les émissions pour espérer influer sur le climat. Rappelant que d’autres pays utilisent à tour de bras des combustibles fossiles pour se chauffer ou se rafraîchir, il estime plus réaliste le scénario « s’adapter ». « L’adaptation n’est pas une option mais une obligation », considère-t-il.
L’amélioration variétale de plus en plus pointue
Dans un chapitre sur « les leviers de résilience », il nomme l’amélioration variétale « première marche vers l’adaptation ». Cette activité nécessite une bonne dose de discernement et de pragmatisme. Par exemple, l’aggravation des sécheresses estivales conduit les semenciers à mettre au point des variétés de maïs plus résistantes au froid : pour esquiver les périodes de sécheresse d’été aux moments de grande sensibilité du maïs, il peut être intéressant de le semer en février-mars plutôt qu’en mars-avril. Ainsi, paradoxalement, alors que le climat se réchauffe, la résistance au froid devient un élément d’adaptation au changement climatique pour le maïs et d’autres productions. Connaisseur des innovations, l’ancien DG de l’Acta expose les avantages du phénotypage à haut débit au champ par des abris mobiles permettant de cerner de façon plus réelle qu’au laboratoire les caractères les mieux adaptés des plantes, et les prouesses des biotechnologies, capables de modifier de façon très ciblée l’ADN d’une cellule.
Créer de nouvelles ressources en eau
Parmi les technologies d’adaptation, il recense l’agrivoltaïsme comme moyen de protection contre les brûlures du soleil. Rejetant les scénarios de décroissance tels la réduction du recours aux engrais, il évoque « l’innovation frugale » : « Ne faudrait-il pas rechercher d’autres sources de phosphore (et d’azote, NDLR) en recyclant les effluents organiques (déjections animales et humaines) ? ». Un chapitre entier est consacré à la question de l’eau, paradoxale : les besoins de la biomasse augmentent, mais les précipitations estivales diminuent. Il va falloir trouver de nouvelles ressources. « Je ne vois pas comment on peut imaginer une agriculture française performante dans les décennies à venir sans créer de nouvelles ressources en eau », affirme-t-il. Ce qui n’empêche pas, ajoute-t-il, de tout faire pour augmenter la capacité de rétention d’eau du sol, notamment en accroissant son taux de matière organique. Il conclut en répondant « oui, l’agriculture peut s’adapter ». Mais en espérant que ce ne soit pas « en courbant l’échine ».
Actuagri