- mai 5, 2025
- Aucun Commentaire
- 5
L’exploitation forestière dans le Lot : Coupes rases, industrialisation de la filière… la réalité à l’épreuve des faits

Publié le 15 mars, l’article de la Vie Quercynoise / Actu Lot sur les coupes rases dans le Lot a surpris les acteurs de la filière forêt-bois lotoise qui considèrent qu’elles ne représentent qu’une partie réduite de leur activité et ne représente pas les pratiques sylvicoles courantes dans le Lot. Cet article vise ainsi à apporter une vision plus réaliste de l’exploitation des forêts lotoises.
Les coupes rases sont une réalité, elles ont des effets documentés sur le milieu physique et chimique et sur la biodiversité. Ces effets varient notamment selon la taille de la coupe, les conditions locales et s’estompent généralement avec le temps. Néanmoins, les coupes rases ne sont qu’une partie réduite du travail des forestiers (20% de la surface des coupes prévues en 2025 dans les forêts gérées). Elles sont notamment mises en œuvre : Lorsque des forêts vieillissantes, malades ou affaiblies par le changement climatique et les parasites nécessitent une replantation de nouvelles essences. On peut citer l’exemple des taillis de châtaigniers sont souvent trop vieux qu’il est parfois nécessaire de renouveler en engageant des travaux de plantation d’autres essences sur les meilleurs sols pour augmenter la résistance et la résilience de nos forêts face au changement climatique. En fin d’un cycle sylvicole, quand la récolte est suivie d’un renouvellement de la forêt par plantation ou par renouvellement naturel (semis). Les propriétaires forestiers sont alors incités à limiter la taille de la coupe, à prendre toutes les précautions nécessaires pour préserver les sols fragiles (intervention par temps sec) et à conserver si possible des arbres pour préserver un microclimat forestier moins séchant (en particulier sur les Causses). Au-delà des coupes rases, la coupe la plus courante en forêt est la coupe d’éclaircie qui vise à sélectionner les plus beaux arbres susceptibles de fournir du bois d’œuvre. Les exploitants forestiers ont tout intérêt à valoriser au mieux les différentes essences et qualités des arbres afin d’en retirer un meilleur bénéfice économique de même que d’écouler les différents produits aux scieries locales ou aux entreprises les plus proches. La relative faible proportion de bois d’œuvre issu des forêts lotoises n’est pas liée à une volonté délibérée de ne pas valoriser nos bois mais reflète le manque historique de gestion de nos forêts feuillues. La forêt lotoise est jeune, elle a colonisé les parcelles abandonnées par l’agriculture. Les propriétaires ont généralement peu de culture forestière et les besoins de formation et d’information sur la sylviculture sont importants. A l’heure actuelle, les coupes sont faites par des bucherons et/ou par des machines en fonction du diamètre des arbres à couper, de l’accessibilité, de la taille des coupes à effectuer ou de la complexité de la coupe. Comme en agriculture, la mécanisation forestière a permis de gagner en productivité et de pallier le manque de main d’œuvre, le métier de bucheron étant physiquement éprouvant et risqué. L’utilisation de chemins dédiés dans les exploitations forestières (cloisonnements) permet également de minimiser l’impact des machines sur le sol. Nous avons besoin de la forêt pour nous fournir le bois pour nos maisons, nos meubles, notre papier, notre chauffage, etc. Nous avons également besoin d’elle pour capter du carbone, pour préserver la qualité de notre eau, pour nos paysages, nos loisirs (randonnée, champignons, chasse). Et ces besoins ne sont pas antagonistes : on estime que 200 000 m3 de bois sont prélevés en moyenne par an dans le Lot quand la production biologique de bois se situe autour de 700 000 m3 par an. Le prélèvement de bois représente donc moins de 30% de l’accroissement annuel du bois. D’autre part, une fois coupé, le bois continue à stocker du carbone lorsqu’il est valorisé en bois d’œuvre ou en bois d’industrie. Les produits issus de ces coupes commercialisées sont valorisés pour 38% en bois d’œuvre, 37% en bois d’industrie (papèterie, panneaux) et 25% en bois énergie (hors autoconsommation de bois de
chauffage), source Agreste 2022. Plutôt que d’opposer des pratiques forestières (coupes de taillis, sylviculture régulière, irrégulière), il est urgent de prendre conscience de la fragilité de notre forêt face au dérèglement climatique, aux maladies favorisées par les échanges mondiaux, à la pression des grands cervidés. L’avenir est incertain, il est donc impératif pour les forestiers de diversifier les modes de gestion des forêts et ils ont besoin de toutes les solutions techniques pour y parvenir. La règlementation forestière apporte les garanties nécessaires pour favoriser une gestion durable de nos forêts (voir encart). Les conseillers forestiers du CNPF et de la Chambre d’Agriculture sont disponibles pour apporter les conseils adaptés à chaque propriété. Pour en savoir plus sur les chiffres clés de nos forêts : site IGN de l’Observatoire des forêts françaises
Signataires : CNPF, Fransylva, Chambre d’agriculture

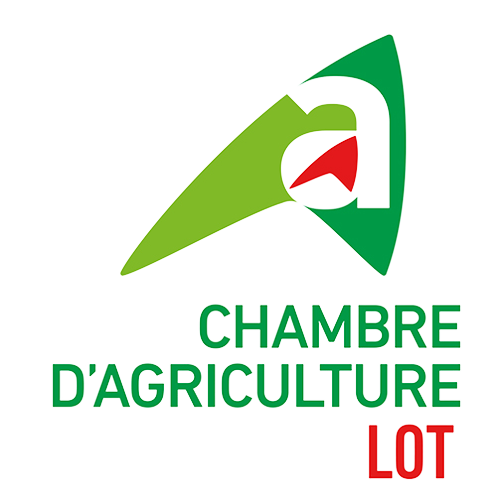

La police forestière en forêt privée incombe aux directions départementales des territoires. Depuis l’ancien régime, le droit forestier français est une singularité européenne qui limite fortement l’exercice du droit de propriété : – le défrichement est soumis à autorisation et à compensation ; – les forêts de superficies supérieures à 20 ha sont obligatoirement gérées conformément à un plan simple de gestion qui règle les coupes ; – dans les forêts non gérées, les coupes de futaie de plus de 1 hectare, suivant leur importance, sont soumises à autorisation. Les infractions, relevées grâce, à des signalements, à l’analyse des données satellitaires et à des tournées de terrain, font l’objet de procédures transmises au Procureur de la République. Instruites en concertation avec l’administration forestière régionale, elles donnent lieu à des amendes assorties systématiquement d’une obligation de remettre les lieux en état. Jean-Pierre CHARPY, DDT du Lot




